
Locmaria célèbre son millénaire
Locmaria célèbre son millénaire
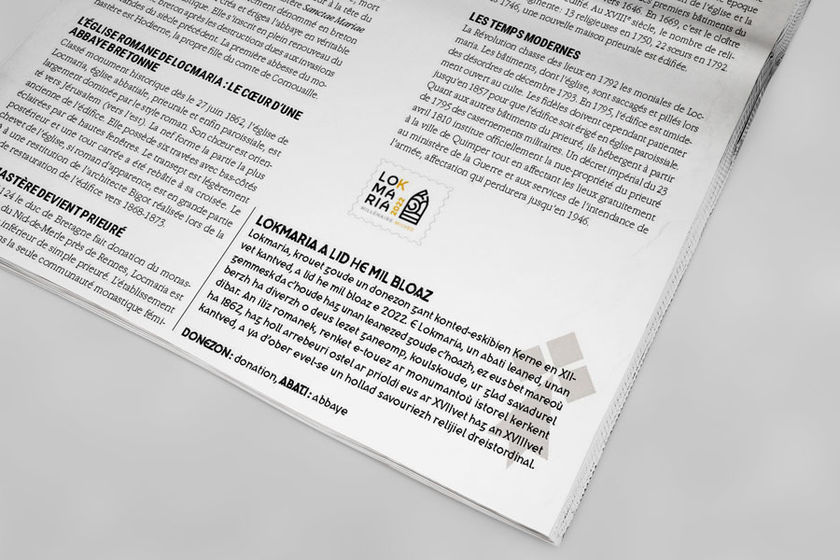 Locmaria, célèbre son millénaire
Locmaria, célèbre son millénaireUne fondation du comte-évêque de Cornouaille
Les archives, nous révèlent l’existence d’une charte conservée aux Archives d’Ille-et-Vilaine qui témoigne d’une donation de terres par Bénédic ou Benoit, évêque et comte de Cornouaille, mort en 1022 et Alain Cainiard son fils et successeur audit comté, au profit du tout nouveau monastère Sanctae Mariae in Aquilonia civitate », communément dénommé en breton Locmaria. Cette donation créa et érigea l’abbaye en véritable seigneurie ecclésiastique. Elle s’inscrit en plein renouveau du monachisme breton après les destructions dues aux invasions normandes du siècle précédent. La première abbesse du monastère est Hodierne, la propre fille du comte de Cornouaille.
L’église romane de Locmaria : le cœur d’une abbaye bretonne
Classé monument historique dès le 27 juin 1862, l’église de Locmaria, église abbatiale, prieurale et enfin paroissiale, est largement dominée par le style roman. Son chœur est orienté vers Jérusalem (vers l’est). La nef forme la partie la plus ancienne de l’édifice. Elle possède six travées avec bas-côtés éclairée par de hautes fenêtres. Le transept est légèrement postérieur et une tour carré a été rebâtie à sa croisée. Le chevet de l’église, si roman d’apparence, est en grande partie dû à une restitution de l’architecte Bigot réalisée lors de la grande restauration de l’édifice vers 1868-1873.
Le monastère devient prieuré
Lorsqu’en 1124, le duc de Bretagne fait donation du monastère à l’abbaye du Nid-de-Merle près de Rennes, Locmaria est reléguée au rang inférieur de simple prieuré. L’établissement demeure néanmoins la seule communauté monastique féminine, de rite bénédictin, dans les diocèses de Cornouaille et de Léon jusqu’au début du XVIIe siècle. Locmaria connaît jusqu’à la fin de l’Ancien Régime des périodes de déclins et d’essors, liées aux qualités diverses, des dames prieures qui en assurent sa direction. L’église sert à la fois à la communauté paroissiale et à la communauté monastique. En 1634-37 la contre-réforme catholique lui apporte un nouvel essor. C’est à cette époque qu’ont lieu la démolition du chœur roman de l’église et la reconstruction du chœur ogival. Les premiers bâtiments du prieuré sont reconstruits vers 1646. En 1669, c’est le cloître moderne qui est édifié. Au XVIIIe siècle, le nombre des religieuses augmente : 13 religieuses en 1750, 22 sœurs en 1792. Dès 1746, une nouvelle maison prieurale est édifiée.
Les temps modernes
La Révolution chasse des lieux en 1792, les moniales de Locmaria. Les bâtiments, dont l’église, sont saccagés et pillés lors des désordres de décembre 1793. En 1795, l’édifice est timidement ouvert au culte. Les fidèles doivent cependant patienter jusqu’en 1857 pour que l’édifice soit érigé en église paroissiale. Quant aux autres bâtiments du prieuré, ils hébergent à partir de 1795, des casernements militaires. Un décret impérial du 23 avril 1810 institut officiellement la nue-propriété du prieuré à la Ville de Quimper tout en affectant les lieux gratuitement au ministère de la Guerre et aux services de l’intendance de l’armée, affectation qui perdure jusqu’en 1946.





